
Connaissance de notre Histoire légionnaire : Radicofani par Paul Bonnecarrère.

Radicofani : devise : « Radicofani, le courage d’oser ! » …
Chaque année, sans relâche, malgrè la Pandémie, nos Camarades et Amis d’origine italienne résidents en Italie, commémorent le combat de la 13e DBLE à Radicofani !
17 juin 1944, la progression de la Division française ralentit puis s’arrête au contact d’un seuil de résistance basé sur Radicofani, les monts Calcinajo et Cotona.
C’est une curieuse histoire que celle de Radicofani qui présente de mystérieuses coïncidences… En effet, cette puissante place forte, clef de voûte de la plaine de Sienne, fut en 1555 défendue victorieusement par les Français et quatre siècles plus tard par d’autres Français…

Radicofani, dans un paysage tourmenté, tâché d’ocre jaune et vert qui se situe au sommet d’une terrasse rocheuse dans un paysage tourmenté aux parois verticales, un donjon carré, très étroit, très haut et massif.
Voila pour le décor mais l’histoire qui suit ne serait pas compréhensible si, en préambule nous ne parlions pas de l’Auteur des récits qui suivront cette introduction.
J’ai rencontré monsieur Paul Bonnecarrère dans les années 70, alors que j’étais jeune sergent « rédacteur-correcteur » à Képi Blanc magazine. J’avais alors pour mission, entre autres, de gérer les planches-photos-contacts. A sa demande, je trouvais la photo qui devait illustrer la première de couverture de son livre « la guerre cruelle » qu’il s’apprêtait à publier. Cet écrivain-journaliste avait une admiration et reconnaissance pour la Légion depuis qu’elle l’avait recueilli alors que son avion venait de s’abattre dans le désert saharien au milieu de nulle part. C’est alors qu’il décida d’écrire plusieurs livres qui porteraient sur la Légion.

En 1974, fort de son succès d’écrivains de roman de guerre, il lui est demandé d’écrire treize feuilletons pour l’ORTF et la participation de plusieurs régiments Légion étaient sollicités. Nous nous retrouvions replongés dans l’ambiance d’héroïsme, de sacrifice, de virulence et de folle bravoure qui nous a envouté dans ses précédents récits, tous emprunts d’une vérité historique indiscutable.

Le livre « douze légionnaires » commence par « Radicofani, je partage les extraits passionnants de ce maitre incontesté du récit de guerre qui mérite d’être connu.

Radicofani, 18 juin 1940 :
Depuis plus d’une heure, sous une pluie fine dont le protègent mal ses vêtements en loques, Renato Moretti guette une occasion favorable d’aborder un ofiicier.
Efflanqué, tôt grandi, le visage tout en os, où brillent des yeux fiévreux, les cheveux embrousaillés, dégoulinant d’eau, l’adolescent se fond dans les ruines qui l’entourent. De l’autre côté de la pizzetta creusée de caractères géant, se dresse la mairie, intacte au milieu des décombres. Elle sert de PC au 1er bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère.
Le village, Aqua Tendente, aux pieds du monte Amiata, est le dernier avant le col de Radicofani qui domine de ses 1200 mètres l’ensemble d’une ligne de défense fortement tenue par les Allemands. Au-delà s’étendent les vallées de la Toscane.
Des légionnaires entrent et sortent du PC. Aucun ne prête la moindre attention à Renato.

Il ne diffère en rien des gosses hâves et déguenillés qui rôdent sans cesse autour d’eux depuis leur débarquement à Naples, trois mois plus tôt. Les légionnaires se sont vite habitués à ces enfants qui surgissent silencieusement des ruines à chaque bivouac, une expression attentive sur leur visage précocement vieilli.
Renato observe ces allées et venues. Il devine que le bataillon est sur le point d’attaquer. Les Allemands ont transformé le Radicofani en forteresse. Ils ont dissimulé de l’artillerie lourde dans des grottes à flanc de montagne. Ils comptent retarder ainsi la marche victorieuse des troupes alliées, le temps en tout cas d’organiser une nouvelle ligne de défense beaucoup plus au nord.
Renato n’a pas eu à violer les secrets des états-majors. Il connaît la montagne, la position des canons, et toute cette agitation autour du PC du bataillon le renseigne sur l’imminence de l’attaque.
La bruine se transforme en averse, les ruelles en ruisseaux bourbeux où les soldats s’enfoncent en jurant. Renato s’efforce de ne pas bouger, le cou rentré dans ses épaules pour ne pas laisser pénétrer l’eau le long de son dos ; il grimace sous la pluie et regarde obstinément en avant. Soudain son expression se fige : une jeep vient de déboucher à toute allure sur la place. Ses roues soulèvent des gerbes de boue. Un officier est assis à côté du chauffeur. Renato le connaît de vue : c’est cet officier qu’il guette.
Le gamin se précipite.
« Signor commandante, signor commandante ! »
L’officier ne se retourne pas. Il a bien d’autres soucis en tête. Ces petits mendiants presque nus, effrontés, teigneux, font partie du décor de l’Italie en guerre, comme les arbres calcinés, les champs labourés par les bombes, les maisons éventrées où s’accrochent encore de pauvres vestiges de vie. Il ne les voit même plus.
« Signor commandante, mi ascolti. Devo parlarle. Mi ascolti ? E importantissimo ! »
Renato s’époumone. La jeep contourne un cratère, freine brusquement devant la mairie. L’officier saute à terre, s’engouffre à l’intérieur du bâtiment. La sentinelle a tout juste le temps de présenter les armes.
Renato s’arrête, essoufflé, rageur, il crache dans la direction où a disparu l’officier. La sentinelle et le chauffeur l’observent en riant. Comme s’il ne suffisait pas d’avoir craché, le gamin fait un bras d’honneur. Négligemment, du canon de son arme, la sentinelle lui fait signe de s’écarter. Renato hausse les épaules et s’éloigne, ses pieds nus clapotant dans la boue.
Le PC du capitaine Grandjean, au res de chaussée de la maison, est installé dans l’ancien bureau du maire. Les bombardements ont épargné le gros œuvre, mais il n’y a plus un carreau aux fenêtres. La couche épaisse de plâtras qui recouvrait le plancher à l’arrivée du bataillon a été méticuleusement repoussée contre le mur. Une photo en couleurs du Duce pend de guingois au dessus de la porte et s’agite avec des froissements dans les courants d’air.
Quand le capitaine Grandjean pénètre dans le bureau, le lieutenant Philippe et le lieutenant Dumas l’attendent. A l’expression préoccupée de leur chef, les deux jeunes officiers comprennent que l’offensive doit être lancée incessamment. C’est ce que leur confirme d’entrée Grandjean en déroulant les cartes du secteur : l’attaque du Radicofani débutera à l’aube du 19 juin. L’effort américain portera sur le flanc est du monte Amiata ; les canadiens feront porter le leur sur le flanc ouest.
« Et nous ? » demande Philippe.
Le capitaine Grandjean hoche la tête.
« Nous ? notre mission est formelle : le bataillon attaquera au centre pour créer une diversion. »
Philippe siffle entre ses dents. Son corps long et plat se redresse sous l’effet de l’indignation.
« Au centre ! Mais qu’est-ce qu’ils veulent ces Ricains ? Nous suicider ?
« C’est logique », remarque calmement Dumas.
Au contraire de Philippe, toute sa personne dénote la pondération. « Nous allons servir de cible aux obusiers allemands.
_ Logique ou pas, ce sont les ordres. Je n’y peux rien, trancha Grandjean.
_ Les ordres ! ils nous font le coup du Belvédère ! s’exclame Philippe. C’est une mission de sacrifice.
_ Et alors ?
_ Il n’y a pas une chance sur cent de réussir ! »
Grandjean contemple les deux lieutenants, il commence à s’amuser.
« Réussir quoi ? demande-t-il. A prendre le monte Amiata de front ? Même les Amerlocs ne nous en demandent pas tant !
_ Tiens ! c’est ce que je leur reproche, déclare Philippe avec mauvaise foi. Ils nous sous-estiment la Légion ! Pourquoi parler de diversion ? J’aime faire les choses proprement : on la prendra leur taupinière ! »
Grandjean n’en a jamais douté.
« On donne quartier libre aux gus ? s’enquiert Dumas, toujours pratique.
_ D’accord. Mais double Les patrouilles de police. Qu’on ramène laviande soûle à partir de 20 heures.
Heure H : 5 heures 30. Réveil général : 4heures. »

Comme la mairie du village, le débit de boissons de Guido Teveri, baptisé pompeusement « Grand Café Tivoli », a échappé partiellement à la destruction. C’est une salle voûtée au sous-sol d’une bâtisse qu’un obus a éventré. Pour y accéder, les légionnaires trouvent plus simple de passer par la brèche, plutôt que de descendre les quelques marches de l’entrée ; ils se laissent tomber au milieu des tables par un trou du plafond. Cette façon de procéder déclenche des rires sauvages à chaque nouvelle arrivée. Ce que Teveri ne dit pas, c’est que les Panzergrenadieren allemands faisaient exactement la même chose trois jours plus tôt.

Pour l’instant Teveri surveille du coin de l’œil une table où six légionnaires ivres qui sont aux prises avec quatre filles tapageuses qui essaient de leur soutirer de l’argent. Parmi elles, une adolescente, presque une enfant, son corps gracile nu sous une robe trop large pour elle, qui lui tombe comme un sac, les pieds nageant dans des chaussures à talons-aiguilles, se montre la plus effrontée. Pourtant on devine que cette impudence est forcée.
Teveri n’est pas le seul à observer ce qui se passe à cette table. Gianni, un légionnaire italien, suit la scène des yeux. C’est un homme d’une quarantaine d’années, au visage marqué de rides où la boue des derniers jours s’est incrustée comme un tatouage. Il est carré d’épaules, mais d’une taille nettement au dessous de la moyenne, ce qui lui donne une apparence difforme.
A la table des légionnaires, un gigantesque Polonais a assis de force l’adolescente sur ses genoux. Soûl à crever, les yeux fous, violacé, il frotte la fille contre lui. Celle-ci apeurée, se défend mal. Le Polonais éructe des mots sans suite : « Cigarettes… nylon… chocolat… » qui sonnent comme autant d’obscénités.
Soudain Gianni se lève. Il avance jusqu’à la table, saisit l’adolescente par le bras et, d’une traction brutale, la remet sur ses pieds. Cloué à sa chaise par l’alcool, le Polonais ne réagit pas. Pas encore…
« Comment t’appelles-tu ? « demande Gianni en italien.
L’adolescente, surprise par la voix sans accent, répond spontanément :
« Alida Moretti, monsieur.
_ Quel âge as-tu ? »
Cette fois la réponse tarde.
« … Dix-huit ans. »
Teveri intervient.
« Elle ment ! elle n’a que quinze ans. Ca fait au moins dix fois que je lui défends de venir… Mais va te faire fiche ! Elle se glisse avec les autres. Seulement, je l’ai prévenue : si son frère la trouve ici, il la tuera ! »
Le Polonais est enfin sorti de sa torpeur. Il vient de se lever. Il est pourpre, les yeux exorbités de haine. Son cou de taureau où les veines saillent comme des cordes se gonfle. Il va cogner.
Gianni n’a pas lâché Alida. Il saisit une bouteille à moitié pleine de vin et la brise sur la tête du molosse. L’homme tombe à la renverse. Une fills gueule. Devant le goulot brisé que Gianni tient toujours à la main, les légionnaires hésitent. Le silence devient insupportable.
Derrière son comptoir, Teveri reste bouche bée.
D’une manière inattendue, Alida réagit la première. Elle essaie de se dégager, tout en hurlant des insultes. Elle se débat, lance des coups de pied dans le vide. L’intervention de Gianni la frappe comme une formidable injustice. De quoi se mêle cette brute ? Le Polonais allait sûrement lui donner ces choses dont elle a envie, tous ces trésors que les soldats gaspillent avec une révoltante inconscience.
La rage puérile de la jeune fille, ses efforts désespérés pour se libérer détendent l’atmosphère. A présent hilares, les légionnaires ne quittent pas des yeux son jeune corps qui se tortille frénétiquement. Les jambes de la gamine volent dans toutes les directions.
Le Polonais s’est relevé en grognant. Il essuie le vin et le sang qui maculent son visage, s’effondre sur une chaise, les yeux vitreux, la bouche dégueulant des mots incompréhensibles.
Gianni traîne Alida jusqu’à la porte. Sans s’arrêter, il demande au patron :
« Où habite-t-elle ?
_ A gauche en sortant, la seule bicoque encore debout. »
Pour y parvenir, il faut escalader des maisons qui ne sont plus que des amas de décombres. Alida supplie Gianni de la lâcher. Elle appelle la Madone à son aide, invoque le Christ, tente de se jeter par terre. Mais Gianni demeure insensible à ses simagrées.
Pervenu devant la maison, il frappe à la porte, sans lâcher la gamine. C’est Renato qui ouvre.
« C’est ta sœur ? »
L’adolescent confirme d’un signe de tête. Gianni pousse Alida devant lui.
« Qu’est-ce que tu lui veux ?
_ Rien. Je la ramène. C’est tout. »
Alida se faufile à l’intérieur. En passant, elle fait mine de se protéger la tête, comme si Renato allait la frapper.
« Entre. »
La salle commune est enfumée. Alida a traversé la pièce en courant, s’est réfugiée dans un coin près de l’âtre. Gianni regarde autour de lui avec curiosité. Renato l’observe, perplexe. Ce soldat qui parle sa langue sans accent le déconcerte.
« Tu es italien ?
_ Oui. »
Le visage de l’adolescent s’éclaire.
« C’est pour ça que tu l’as ramenée ? »
Gianni fronce les sourcils. Pour une raison qu’il ne s’expliquue pas cette question l’énerve.
« Elle est trop jeune pour traîner dehors », dit-il avec colère.
Renato le regarde incrédule. Trop jeune ! Cette remarque le dépasse. Trop jeune pour faire la putain ? Que tout continue comme avant, malgrè la guerre ? Et lui alors, qu’est-ce qu’il fait avec les alliés ?
« Tu viens d’Amérique ? »
Gianni secoue la tête.
« Non », dit-il.
Et il ajoute :
« Avant la guerre, j’étais en Espagne. »
Comme renato visiblement ne comprend pas, il précise :
« Avec les antifascistes.
_ Les Rouges ? »
Gianni hausse les épaules. Il n’a pas envie d’expliquer.
Dans son coin Alida ricane.
« C’est un communiste, dit-elle.
_ Ta gueule ! » hurle Renato qui veut tirer cette affaire au clair.
« Si c’est comme ça, attaque t-il, tu devrais être avec les patisans. Pas avec les Français.
_ Je me suis engaé en 39. Dans la Légion. L’Italie n’était pas encore en guerre, tu comprends ? »
Renato réfléchit.
« Alors tu es un soldat de métier ? »
Gianni soupire. Cette discussion le fatigue.
« Quelque chose comme ça, dit-il pour en finir.
_ Depuis trois jours j’essaie de parler à ton commandant.
_ Qu’est-ce que tu veux ?
_ lui espliquer comment on peut monter dans la montagne par-derrière.
_ Pourquoi ?
_ vous n’y arriverez jamais de ce côté. Les grottes sont pleines de canons.
_ Alors ?
_ Alors, ça sera comme à Cassino. Vous ne partirez plus. Les Allemands bombarderont le village jusqu’à ce qu’il ne reste plus une pierre debout. On aura tout perdu. »
C’est au tour de Gianni de ne pas comprendre.
« Tu veux nous aider à rosser les Allemands ? »
Renato ne se donne même pas la peine de mentir.
« Je veux que tout ça finisse », dit-il.
Il se tient très droit, le visage fermé. Implacable. C’est tout juste s’il ne dit pas : « Foutez le camp. Laissez-nous vivre ! »
Gianni voudrait lui expliquer que eux, les Alliés, ce n’est pas pareil, qu’ils sont ici justement pour les libérer, mais il y renonce, découragé…
« Tu es déjà monté dans la montagne ? demande-t-il.
_ Trois fois. Tout seul. Les Allemands croient que c’est impossible, alors ils ne surveillent pas l’autre versant. Je connais le chemin pour contourner la montagne et, après, la voie pour grimper. Je pourrais le faire sans mes yeux. Chaque fois je suis monté la nuit. »
Gianni est sceptique. Le gamin cherche à se rendre intéressant.
« Qui me prouve que tu ne mens pas ? » dit-il.
Sans répondre, Renato se dirige vers un buffet dont il sort des boites de conserves qu’il pose sur la table. Cesont des conserves allemandes.
« Tu crois que j’y vais pour la promenade ? Il y a un dépôt de vivres en haut. Je les ai volées : des boites de porc, de poisson, de légumes. »
La fierté perce dans sa voix.
Gianni est convaincu. Il se lève et se dirige vers la porte.
« Viens avec moi, dit-il. Cette fois tu vas lui parler au capitaine. »
Sans l’interrompre une seule fois, le capitaine Grandjean a écouté les explications de Gianni qui fait office de traducteur. A présent il scrute le visage de Renato. Le gamin ne baisse pas les yeux. Malgrè ses vêtements en loques et ses pieds nus, il est parfaitement à l’aise. Debout, les lieutenants Philippe et Dumas se contentent du rôle de spectateurs.
« Quel âge as-tu ? demande Grosjean.
_Dix-sept ans. »
Le capitaine hoche la tête. Il hésite. Le gamin a l’air sûr de lui, mais ses motifs ne sont pas convaincants. Ils se retourne vers ses subordonnés.
« Qu’en pensez-vous ? »
Philippe s’emballe aussitôt.
« Formidable, mon capitaine ! Il pourrait conduire une vingtaine d’hommes au pied du piton, grimper et fixer au sommet une corde de rappel. Après tout, qu’est-ce qu’on risque ,
_ la vie de vingt gus et celle du gosse », remarque doucement Dumas.
Philippe ne se laisse pas arrêter.
« des gosses, il y en a d’aussi jeunes que lui au bataillon. Quant aux vingt gus, quils participent à l’attaque frontale demain à l’aube ou a un commado derrire les positions allemandes cette nuit, c’est pas loin d’être le même tabac. »
Grandjean réfléchit une minute. Toutes sortes d’hypothèses se heurtent dans son esprit, y compris celle d’un traquenard. Brusquement il se décide.
« D’accord, dit-il au gamin qui ne l’a pas quitté des yeux, je te fais confiance. » Puis à l’adresse de Gianni : « Démerde-toi pour lui trouver un uniforme et fais-lui couper sa tignasse ! »
Gianni traduit. Renato secoue énergiquement la tête.
« Jamais ! dit-il en crachant les mots. Ton uniforme, tu sais où tu peux te le mettre !
_ C’est un ordre, hurle Grandjean que le refus du gamin exaspère. Si ce petit con se fait faire aux pattes par les chleus en civil, tu sais ce qui l’attend. Fais-lui rentrer ça dans le crâne avant qu’il ramasse un coup de pied au cul ! »
Gianni ne prend pas la peine de traduire. Il soulève Renato et le sort du bureau comme un paquet.
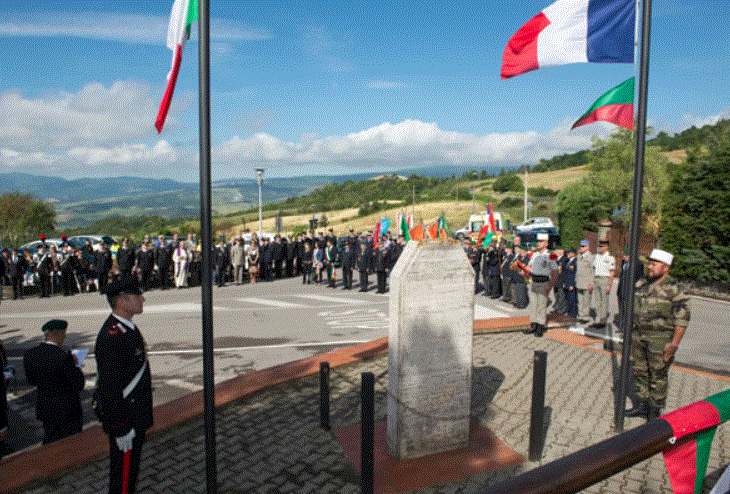
La grande tente de l’antenne chirurgicale à la sortie du village est pleine de blessés français et allemands. Gianni déambule dans la travée. A deux reprises il s’arrête pour consulter la fiche qui pend au pied de chaque lit, puis repart en secouant la tête.
Au bout de la rangée de droite gît un légionnaire de sa compagnie. Il a été blessé à la tête par l’explosion d’un obus de mortier. Gianni s’approche. Le légionnaire le fixe d’un air hébété. Quand il reconnaît Gianni, son expression égarée fait place à un sourire de contentement. Ils ne sont pas particulièrement amis mais, dans ce lieu, n’importe quel visage familier est le bienvenu. Autour d’eux, sous la toile que cingle la pluie, dans la chaleur étouffante, des infirmiers vont et viennent silencieusement.
« Tu mesures combien, Fernand ? » demande Gianni au blessé.
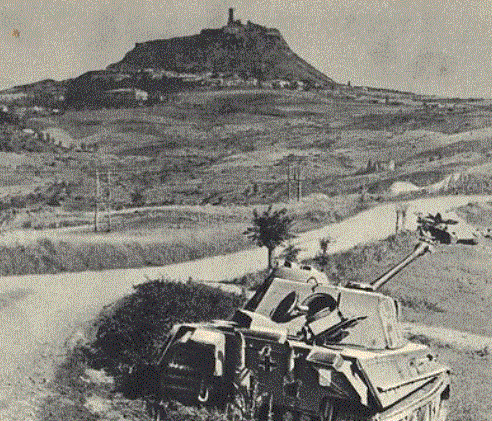
Le légionnaire le regarde sans comprendre. Une lueur d’inquiétude s’allume dans ses yeux. Cette question lui paraît pleine de menaces obscures.
« Pourquoi tu me demandes ça ? dit-il avec angoisse.
_ J’ai besoin dee tes fringues. Ordre du Capitaine. »
Il decroche le battle-dress du blessé suspendu à un porte-vêtement.
« Dis donc ! C’est mes sapes ! t’es dingue ou quoi ! »
A côté d’eux, un blessé endormi pousse un cri et se réveille. Gianni sursaute.
« T’entends, dit-il avec reproche, tu déranges tout le monde.
_ Eh ben, merde alors, grommelle le blessé que la mauvaise foi de Gianni estomaque. Tu peux te les garder, mes fringues ! » et il ajoute, sinistre : « De toute façon j’en ai plus besoin. »
Il sait que c’est faux, que sa blessure n’est pas très grave, mais ce rôle de grand blessé qui n’en a plus pour très longtemps est pour l’instant sa seule défense. Gianni n’est pas dupe.
« C’est ça, ducon, s’exclame-t-il, le vieux et moi on est des détrousseurs de cadavres ! où est ton képi ?
_ Ah non ! mon képi, je le garde », gueule le blessé.
Gianni comprend qu’il est inutile d’insister. D’ailleurs Renato a besoin d’un casque, as d’un képi. Etcelui de Fernand est troué.
Sous les ordres du lieutenant Philippe, les trois sections sont prêtes à partir.
Les cheveux rasés, dans son battle-dress un peu trop grand pour lui, chaussé de pataugas, Renato Moretti est méconnaissable. Il a déjà oublié son refus de porter l’uniforme. Le gamin est parfaitement conscient de sa métamorphose. Il a perdu ses allures de chat errant. Avec le mimétisme propre à son âge, il singe les manières décontractées d’un vieux soldat. Les hommes qui font partie du commando l’ont adopté immédiatement. Il a partagé leur repas et discuté le coup comme s’il appartenait au bataillon depuis Narvik. Gianni ne le quitte pas d’une semelle. Entre le légionnaire et l’adolescent, c’est le coup de foudre de l’amitié.
La pluie a cessé. Un brouillard translucide monte de la terre détrempée où les semelles s’enfoncent avec un bruit de ventouse.
Renato a quitté la route de radicofani que l’ennemi ne cesse de surveiller, l’éclairant de loin en loin par des fusées parachutes, et pris à travers bois, Philippe et Gianni marchent derrière lui. Les légionnaires suivent en file indienne.
Le sentier s’élève peu à peu à flanc de montagne, en lacets étagés les uns au dessus des autres. Renato avance sans effort, du pas tranquille des montagnards auquel s’adapte celui de la Légion.
Soudait le gamin s’arrête, fait signe aux hommes derrière lui de s’accroupir. Un sentier plus large croise le leur, s’enfonçant dans un bois de pins. Aplatis sur le sol humide et glissant, les légionnaires écoutent . Bientôt le martèlement d’une petite troupe en marche se fait entendre. Du bras Philippe impose le silence. Il lève lentement son pistolet mitrailleur, le doigt sur la détente, prêt à tirer s’ils sont décoouverts. Derrière lui, les hommes l’ont imité, retenant leur souffle.
Une section de Panzergrenadieren débouche à moins de dix mètres. Les Allemands marchent les uns derrière les autres. L’un d’eux dérape sur les aiguilles de pins et jure. Des rires fusent. Renato écoute, attentif, leurs pas décroître. Le commando se remet en marche. La végétation s’éclaicit. La terre spongieuse se transforme en caillasse où ne s’accrochent plus que des buissons rabougris. Le sentier jusque-là bien tracé se perd dans un terrain en pente raide que surplombent des rochers. Cette ascension nocturne n’en finit pas. Le vent souffle de l’ouest en rafales. Le piton du monte Amiata très haut au dessus de leurs têtes bouche complétement l’horizon. Le lieutenant Philippe guette avec inquiétude les premières lueurs du jour. Il consulte sa montre. Dans une heure l’est s’embrasera, mais il croit déjà déceler des traits plus clairs dans la nuit qui les environne. Renato monte toujours. Le sentier a complétement disparu, avalé par d’immenses dalles polies qui paraissent prêtes à se décoller de la pente vertigineuse. Les légionnaires arrivent enfin aux pieds d’une haute falaise. Cette barre rocheuse interdit l’accès au sommet. C’est elle qu’il faut escalader maintenant. Les hommes se regroupent autour de Renato. Ils se tordent le cou pour tâcher d’apercevoir, quarante mètres plus haut, le faîte de la montagne. La muraille est séparée en deux par uns fissure qui la zèbre d’un trait plus sombre. Renato la désigne du doigt à Gianni et à Philippe. C’est par là qu’il va grimper.
Calmement, après s’être défait de son sac, Renato enroule en diagonale sur son torse un long filin de nylon. Pendant ce temps, Gianni sort d’une sacoche un poids d’un kilo surmonté d’un anneau. Il étale sur le sol trois mouchoirs les uns sur les autres, pose le poids au centre et replie les mouchoirs par-dessus. Il extrait ensuite d’une des poches de son battle-dress un étui de préservatifs qu’il déchire entre ses dents, déroule une première capote anglaise et l’étire jusqu’à pouvoir y introduire le poids. Les légionnaires suivent tous ses gestes avec intérêt. Gianni renouvelle l’opération deux fois avec deux autres préservatifs, puis il remet le poids à Renato. Seul l’anneau dépasse de l’enveloppe protectrice. Renato le fixe à un mousqueton de sa ceinture.
Le lieutenant Philippe s’approche du gamin. Il lui presse l’épaule d’un geste affectueux d’encouragement. Renato plonge la main dans l’échancrure de sa chemise, en sort une médaille qu’il porte au cou, l’embrasse et attaque la paroi.
S’aidant des pieds et des mains, profitant des moindres aspérités sur le roc qui devient de plus en plus abrupt, Renato commence son ascension. Il s’élève lentement, le corps pris entre les deux mâchoires de la faille, mesurant ses gestes, tâtant les prises, gagnant petit à petit de la hauteur. D’en bas, les légionnaires suivent son escalade avec angoisse. Le moindre dérapage peut être fatal à l’enfant. S’il venait à tomber, son corps s’écraserait aux pieds de la muraille sans que rien n’amortisse sa chute.
Renato s’élève ainsi d’une trentaine de mètres, puis s’arrête, le corps coincé. Les légionnaires le voient repartir, mais cette fois, non plus dans la faille devenue trop étroite pour lui, mais au-dehors, le corps collé à la paroi, s’aidant, pour monter, des rebords de la fissure. C’est d’autant plus risqué que les arêtes sont tranchantes comme des lames et n’offrent presque pas de prise. Farouchement, Renato continue. A chaque effort, il gagne quelques centimètres en hauteur. Anxieux, les légionnaires n’osent pas bouger. Ils ont l’horrible impression qu’un geste ou un murmure de leur part déclenchera la catstrophe. Enfin, ils voient le gamin se rétablir sur la crête et dispara^tre dans l’obscurité.
Renato exténué, se couche sur le dos. La bouche grande ouverte, il reprend lentement sa respiration. Son cœur bat follement. Un long moment, le petit italien savoure sa joie. Il a réussi ! Cette pensée l’enivre. Pour peu il se mettrait à crier. Et déjà un cri triomphe monte à ses lèvres quan il se rappelle soudain la raison de son exploit. Il jette un regard effrayé autour de lui.
Il est sur un plateau entre les deux versants du monte Amiata. A pic du côté de la muraille, le terrain descend en pente douce jusqu’aux éperons où se trouvent les grottes. Tout est désert. Rassuré, il ddégage le rouleau de filin, fixe le poids, parcours quelques mètres jusqu’à une corniche en surplomb…
Quarante mètres plus bas, les légionnaires ont logé et arrimé quatre fusils mitrailleurs et une caisse de munition dans des pneus.
Renato laisse glisser le filin entre ses doigts. A plusieurs reprises le poids est bloqué par une aspérité. Renato lui fait franchir l’obstacle dans un mouvement de balancement. Grâce à l’enveloppe qui protège le poids, l’opération se déroule sans bruit.
Le lieutenant Philippe s’empare du poids qui pend au-dessus de sa tête. D’un coup de poignard commando, il tranche le filin au ras de l’anneau. Gianni lui tend l’extrémité d’une longue corde à nœuds. Le lieutenant l’attache solidement au filin, puis tire sur celle-ci à deux reprises. C’est le signal qu’attend Renato. Le filin remonte doucement le long de la paroi. Aux pieds de Gianni, le tas formé par la corde de rappel s’amincit rapidement.

Renato a attaché la corde à un rocher. Couché à plat ventre, il suit l’ascension des légionnaires. Bien qu’ils soient aidés par la corde à nœuds, les hommes ont du mal à se hisser les uns après les autres jusqu’au sommet. Certains se heurtent durement au rocher. On entend les armes cliqueter. Des pierres se détachent. Parvenus sur le plateau, les légionnaires s’aplatissent autour de Renato.
Lorsque le commando est prêt à s’ébranler, le gamin se glisse silencieusement dans l’ombre. Le terrain, nu, où se dressent par-ci par là des rochers aux formes étranges, n’offre presque aucune protection. Il suffirait d’une sentinelle pour que le coup de main échoue. Mais les Allemands, confiant dans la muraille, ne surveillent que la vallée et le versant d’aqua Tendente.
Au bout d’une descente qui leur paraît interminable, les légionnaires parviennent au dessus des grottes. Huit obusiers de 105 sont répartis dans ces casemates naturelles. C’est sur leur tir plongeant, précis et meurtrier à toutes distances, que les Allemands comptent pour briser l’attaque alliée.
Renato désigne une route qui plonge en demi-cercle. On aperçoit distinctement les tranchées d’accès aux grottes, raccordées les unes aux autres par des ouvrages en superstructure, creusés dans les roches.
Trois légionnaires installent rapidement un FM, de manière à prendre la route en enfilade.

Le lieutenant Philippe divise le commando en trois groupes. Chacun a pour mission de s’emparer d’une des grottes. Les hommes se séparent en silence et s’évanouissent dans la nuit. Tout s’est fait par signes. Aucun mot n’a été échangé. On dirait des sourds muets discutant entre eux.
Suivi de Renato et de Gianni, le lieutenant Philippe rampe sur un ressaut rocheux au-dessous duquel s’ouvre un trou sombre. En se penchant on aperçoit le tube du canon qui dépasse. Couchés de tout leur long à plat ventre, les deux hommes et le gamin sont confondus avec la roche recouverte de lichens. Le jour pointe sur les hauteurs. En bas, très loin, la vallée est encore plongée dans l’obscurité. Le lieutenant Philippe conserve les yeux rivés sur la tratteuse de sa montre.
A l’orée d’un petit bois où le brouillard s’effiloche, le bataillon attend, embusqué, l’heure de passer à l’attaque. Comme souvent avant le déchaînement de l’enfer, un lourd silence pèse sur la campagne. Aucun bruit familier ne monte dans l’air traquille, ni chant de coq, ni tintement de sonnailles. Immédiatement après le bois, s’étendent des champs en pente que la route de Radicofani traverse en longueur. Au-delà, à moins de huit cents mètres, le terrain s’élève lentement, par de larges terrasses soutenues par des murettes en pierres sèches, jusqu’au sommet du monte Amiata comparable à la carène d peu ’un navire.
Toute la nuit, des sections srutent avec inquiétude cette étendue immobile et silencieuse sur laquelle dans quelques minutes une grêle de projectiles s’abattra. Il est fou d’espérer que sur cette plaine peu accidentée, continuellement surveillée par l’ennemi, le mouvement du btaillon passera inaperçu. Dès que les premières vagues s’élanceront des rafales d’obus les écraseront,
A moins que…
L’aube est déjà assez claire pour permettre de distinguer les choses. Le lieutenant Philippe se laisse descendre, la tête la première, soutenu par une corde de rappel que Gianni, arc-bouté au ressaut, assure. Le légionnaire parvient à quelques centimètres de l’excavation. Il porte autour du cou une musette remplie de grenades. Il en découpille deux, les lance dans l’embrasure. Aussitôt après l’explosion, suivie d’un cri de terreur aiguë, il en lance d’autres.
Alors, comme à un signal, tout éclate en même temps et de tousles côtés à la fois. Renato éberlué est pris dans un cyclone. A l’attente silencieuse, presque irréelle, a succédé un extraordinaire déferlement de violence et de bruit. L’artillerie allemande se déchaîne. Tout près de lui, les légionnaires attaquent les casemates à la grenade, fauchent au FM les survuvants. Contre-attaqués sur leurs arrières, ils retournent leurs armes, se transforment en défenseurs des ouvrages qu’ils viennent d’enlever. Une mitrailleuse isolée ouvre le feu du haut du talus et balaie toute la pente.
Cependant, dans la plaine, le bataillon s’est élancé. Deux obusiers de 105 tirent encore. Les hommes courent, s’aplatissent, se relèvent, parviennent aux premières terrasses où ils se heurtent aux armes automatiques et aux mortiers allemands qu’il faut réduire les uns après les autres.
Le lieutenant Philippe entraîne Gianni et Renato. Tout autour d’eux fusent des petites gerbes de terre et des cailloux. Ils parviennent derrière le blockhaus qui n’a pas été investi. Les cadavres de deux légionnaires gisent dans le couloir rocheux qui mène à la porte. Ils ont été déchiquetés par une grenade. Renato reste figé sur place. Il ne peut détacher les yeux des deux corps mutilés qui obstruent le passage. N proie à une espèce de rage incrédule, Gianni tire au pistolet mitrailleur par-dessus les cadavres. Ses balles arrachent des éclats de bois à la porte qui résiste. D’un geste, le lieutenant l’arrête. Il bondit par-dessus les corps, enfonce la porte d’un coup de pied, lance une grenade, se plaque contre le rocher. La violence de l’explosion jette Renato au sol. De l’intérieur de la grotte, une mitrailleuse tire des rafales. Le lieutenant est toujours adossé au rocher. Les balles ricochent sur la pierre ou s’enfoncent avec un bruit mou dans les corps étendus sur le sol. Gianni comprend que les Allemands ont dû se barriader solidement à l’intérieur. Il saute à son tour par-dessus les cadavres et se jette dans la grotte en tirant. Philippe s’arrache au rocher et le suit. Leurs armes crépitent frénétiquement. Brusquement le tir s’arrête.
Renato est conscient d’un changement autour de lui, mais son cerveau ne parvient pas à en saisir la nature. Il relève la tête. Le lieutenant Philippe se tient dans l’embrasure de la porte. Son visage est très pâle. Le fracas des armes s’est éloigné. Secoué par des nausées, Renato se met péniblement debout. Il s’avance comme un automate, enjambe les cadavres, s’approche du lieutenant. Celui-ci s’efface pour le laisser entrer.
Gianni gît sur le dos, la main droite encore crispée sur son pistolet mitrailleur, les yeux fermés. Renato le regarde, incrédule. Quelques minutes plus tôt, le grand légionnaire italien était en vie, et Renato lui parlait. Maintenant il est figé dans une immobilité telle qu’elle semble artificielle. Il va sûrement se passer quelque chose d’inouï, quelque chose de fantastique dont cette immobilité bizarre est l’annonce. Mais rien ne se produit. Aucun miracle ! Gianni ne se relève pas. Renato comprend qu’il ne bougera pas. De lourdes larmes silencieuses se mettent à couler sur son visage d’adolescent trop vite mûri par la guerre.
Le bataillon quitte Aqua Tendente. Devant la mairie et le long de la route de départ, des camions attendent, comme enracinés par leurs six roues dans la boue visqueuse qui recouvre tout, les décombres, la chaussée défoncée, les véhicules, les hommes… Les légionnaires, ployés sous le faix du paquetage, des armes, des cartouchières, se tiennent en groupes compacts, section par section, guettant l’ordre d’embarquer. Comme toujours il y a du retard. Les hommes grommellent : impossible de s’asseoir dans la boue où l’on enfonce par endroits jusqu’aux genoux. Les caisses de grenades, les cartons d’obus de mortier, empilés sur le bord de la route, offrent aux plus malins quelques rares sièges. Les autres attendent, debout, le visage maussade. Ils ont perdu le compte des jours et des nuits passés sous une pluie battante dans la glu noire des montagnes. Huit, dix jours peut-être, sans avoir eu la chance de changer de vêtements, de s’enrouler pour dormir dans une couverture sèche, d’enfiler une paire de chaussettes qui ne soit pas un torchon pourri… Sur la place de la mairie, la compagnie du lieutenant Philippe attend comme les autres. Au début, des plaisanteries, des encouragements, des rires donnaient à ce rassemblement un petit air de parade malgré les uniformes boueux. A présent, les jambes flageolantes, les mains crispées sur les bretelles de leurs paquetages, les légionnaires, la bouche mauvaise, piétinent sous la pluie comme un troupeau dans un parc. Parmi eux, un visage jeune, souriant, un uniforme tout neuf, encore sec : le légionnaire Renato Moretti.
Après la prise du monte Amiata, le jeune italien a demandé son incorporation au bataillon. Aux questions du capitaine Grandjean, il s’est contenté de répondre qu’il prenait la place de Gianni. Pour Renato cette longue attente fait patie de l’excitation du départ. Il n’en voit pas le côté accablant. Tout est bien trop nouveau, l’amitié des hommes, la griserie d’appartenir à un corps de combat, l’acier des armes, le sentiment d’invulnérabilité que lui donne cette multitude dont il sent gronder la puissance comme l’orage invisible au fond d’un ciel clair. Mais à mesure que le temps passe, les sourires amicaux, les clins d’œil, les petits signes qui le remplissaient de fierté, se font rares. Il n’y a plus autour de lui que des visages renfrognés, hostiles. Renato commence à se demander avec inquiétude s’il est toujours le bienvenu, si on veut toujours de lui.
Brusquement des ordres fusent. 3O part. » Les légionnaires s’ébrouent, assurent leurs paquetages, saisissent leurs armes, forment les rangs. « On part ! » Le mot court le long de la colonne…
Alida traverse précipitamment la place. La jeune fille cherche son frère, l’aperçoit qui grimpe dans un camion. Elle se précipite, glisse, se rattrape. Mais le camion s’est ébranlé. Les légionnaires penchés sur le hayon la voient. Des mains amicales s’emparent de Renato, le poussent, le tirent, le retiennent solidement quand il se penche par-dessus le rebord du hayon. Alida court de toutes ses forces, le visage levé vers lui. Ses yeux sont pleins de larmes. Leurs mains se touchent, s’agrippent. Le lourd véhicule prend de la vitesse. Des gerbes de boue giclent sous les roues. Renato arrache sa main à l’étreinte de sa sœur. La jeune fille fait encore quelques pas, puis s’arrête…
Un camion la dépasse, un autre d’où jaillissent des plaisanteries et des rires. Accrochés aux ridelles arrières des soldats inconnus la dévisagent. Alida hausse les épaules et reprend lentement le chemin d’Aqua Tendente.






